❌🧠 Pas le genre d'info sur la chaleur que vous attendiez [Neuroscience]
🔥 🌡️ Votre cerveau souffre-t-il en été ? Découvrez pourquoi mémoire et concentration chutent dès 27°C. Les secrets de votre cerveau sous pression.
Salut l’équipe !
J’espère que vous allez tous bien sous cette chaleur. Ça ralenti le cerveau, il n’y a pas à dire (bon et peut-être aussi qu’une semaine de Copains Express, c’est pas si reposant que ça 😂).
Petite question (vous comprendrez plus tard pourquoi) :
Hâte de lire vos réponses 🙂🙌
Allez on attaque avec un sujet… en plein coeur de l’actualité ! 🙌
💡 Pour briller en soirée
Si vous n’avez pas le temps de tout lire, vous trouverez ici les informations les plus croustillantes de notre épisode !
La température idéale pour votre cerveau ? Entre 15 et 18°C - au-delà, vos neurones ralentissent ! 🧠
Les particules de pollution traversent votre barrière cérébrale en moins de 60 secondes après inhalation ⚡
60 jours de chaleur extrême par an pendant 10 ans = 2,8 ans de vieillissement cognitif supplémentaire.
📑 Le Dossier de la Semaine
Chaque semaine, nous disséquons minutieusement une thématique des neurosciences pour vous offrir un éclairage complet et captivant !
🧠💬 🔥 Pourquoi plus il fait chaud, moins vous arrivez à vous concentrer ? Les secrets de votre cerveau sous pression
Cette semaine on rebondit sur l’actualité. La canicule en Europe est bien là, et nos corps tentent de s’y adapter le jour comme la nuit.
FSO ! Oui il fait chaud !
Alors que les vagues de chaleur se multiplient et que les températures globales continuent d’augmenter sur notre petite planète, le réchauffement climatique prend de plus en plus d’espace dans nos têtes.
Et comme vous allez le voir, ce n’est pas que de l’espace mental !
En effet, saviez-vous que ce phénomène planétaire pourrait aussi affecter notre cerveau et nos fonctions cognitives ?
Les neurosciences, commencent à explorer ce lien méconnu, révélant des implications inquiétantes pour notre santé mentale et notre capacité à penser, décider et agir.
Chaleur extrême : un cerveau sous pression
Une première étude publiée en 2020 dans la revue PLOS Médicine a mis en lumière les effets de la chaleur extrême sur les fonctions cognitives.
Les chercheurs ont observé que des températures élevées altèrent :
la mémoire de travail,
la concentration
la prise de décision.
En effet, le cerveau, organe très sensible aux variations de température, doit travailler davantage pour maintenir son équilibre interne. On appelle cette régulation corporelle l’homéostasie. Et son mécanisme est fortement mise à contribution en cas de forte chaleur.
💡 La température idéale pour les performances cérébrales se situe entre 15 et 18°C en extérieur. Au-dessus de 27°C, les fonctions cognitives chutent de près de 1,5% par rapport à cette plage optimale.A l’état normal, le cerveau utilise plus de 20% de l’énergie de notre corps.
Plus l’équilibre interne est modifié par des phénomènes de températures extrêmes, plus celui-ci devra recruter des ressources supplémentaires pour fonctionner de manière optimale !
Cette surcharge thermique peut entraîner une baisse de performance cognitive, notamment chez les populations vulnérables comme les personnes âgées ou celles souffrant de troubles neurologiques.
💡 C’est un peu comme si on passait en mode “économie de batterie” sans vraiment le vouloir.Stress thermique et santé mentale : un cercle vicieux
Au-delà des effets immédiats sur la cognition, le réchauffement climatique pourrait aussi aggraver les troubles de santé mentale. Une autre étude parue dans Nature Climate Change en 2021 a révélé que l’exposition répétée à des températures extrêmes est associée à
une augmentation des symptômes dépressifs
un augmentation des troubles anxieux.
Le stress thermique chronique perturbe la régulation des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, essentiels à la gestion des émotions et au bien-être mental.
De plus, les événements climatiques extrêmes (ouragans, inondations, feux de forêt) peuvent également générer un stress post-traumatique chez les populations touchées.
💡 Une étude longitudinale a révélé que vivre 60 jours de chaleur extrême par an pendant 10 ans accélère le vieillissement cognitif d'environ 2,8 ans par rapport aux personnes exposées à moins de 10 jours.Les neurosciences montrent que ces traumatismes peuvent modifier durablement la structure et le fonctionnement du cerveau, notamment dans des zones du cerveau comme :
l’amygdale (spécialiste des émotions)
l’hippocampe (spécialiste de la mémoire)
Comme pour se protéger, notre cerveau se reforme et joue de sa plasticité pour anticiper les prochains évènements extrêmes.
Pollution, le danger invisible
Le réchauffement climatique s’accompagne souvent d’une augmentation de la pollution de l’air, elle-même néfaste pour le cerveau.
Des recherches récentes, dont une publiée dans The Lancet Planetary Health en 2022, ont montré que l’exposition prolongée aux particules fines (PM2.5) entraînent une pénétration de celles-ci dans le système nerveux central, provoquant une inflammation cérébrale.
Les particules ultrafines (PM0.1) peuvent traverser directement la barrière hémato-encéphalique et atteindre le cerveau en moins de 60 secondes après inhalation, déclenchant des processus inflammatoires immédiats.
Cette neuroinflammation est associée à un risque plus élevé de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.
S’adapter : le rôle de la plasticité cérébrale
Bon, pas très gai tout ça ! Mais comme dans toute belle histoire, la suite sera un peu plus jolie.
Face à ces défis, notre cerveau dispose d’une arme puissante : sa plasticité.
Des études récentes sur la neuroplasticité montrent que le cerveau humain peut développer des adaptations structurelles et fonctionnelles face aux stress environnementaux, notamment dans l'hippocampe et le cortex préfrontal.
Cette capacité à se réorganiser pourrait nous aider à mieux résister aux stress environnementaux.
💡 Des études montrent que les personnes mieux informées sur les enjeux climatiques sont plus susceptibles d'adopter des comportements pro environnementaux et de gérer leur éco-anxiété de manière plus constructive.Construire des circuits neuronaux spécialistes du changement climatique ?
Oui, en quelques sorte.
Notre capacité à s’adapter au monde existe depuis la nuit des temps.
Alors pourquoi ne pas imaginer que malgré l’influence des forts changements climatiques perçus au cours des dernières décennies, notre cerveau ne sera pas s’adapter à ces modulations en interne ?
Se protéger des polluants environnementaux, mieux accepter des modifications de températures du corps ou diminuer une réponse au stress à la suite d’un évènement climatique, les chercheurs sont sur le coup !
Le climat, une urgence invisible pour notre cerveau
Les scientifiques sont unanimes : si nous ne parvenons pas à limiter le réchauffement à moins de 2°C d’ici la fin du siècle, le risque d’impact à long terme sur nos sociétés est réel.
Pourtant, malgré les signaux d’alarme, notre cerveau semble préférer ignorer la menace. Pourquoi un tel déni ?
Le principal obstacle à la lutte contre le réchauffement est d’ordre psychologique.
Paradoxalement, plus les preuves scientifiques s’accumulent → moins les gens semblent préoccupés.
Un phénomène qui s’explique par des mécanismes cérébraux bien précis.
Quand notre cerveau fuit la réalité
L’une des barrières mentales les plus puissantes est la dissonance cognitive.
Notre cerveau a besoin de cohérence pour fonctionner harmonieusement. Or, le réchauffement climatique, par son ampleur et les bouleversements qu’il implique, crée un profond malaise. Il remet en question nos modes de vie, nos habitudes et notre vision de l’avenir.
💡 Le "paralyzing paradox" a été documenté : une surexposition aux informations climatiques peut provoquer une augmentation du cortisol de 53% et désactiver partiellement les zones cérébrales liées à la planification d'actions.Plutôt que d’affronter cette réalité inconfortable, notre cerveau préfère refouler l’information. Comme l’explique Sylvie Granon, chercheuse en neurosciences comportementales, dans son ouvrage Le Souci de la Nature, le cerveau humain déteste les changements.
Ils sont énergivores et stressants. Pour se protéger, il privilégie les comportements automatiques et rassurants, quitte à nier ou minimiser les problèmes.
Une autre barrière mentale identifiée est le catastrophisme. Les messages alarmistes sur le climat, bien que fondés, peuvent s’avérer contre-productifs.
En étant constamment abreuvés d’informations anxiogènes, notre cerveau active ses mécanismes de défense : il évite le problème pour se protéger du stress.
Sans même qu’on s’en rende compte, des biais cognitifs faussent notre perception du réel. Par exemple :
Le biais d’optimisme : on se dit que "ça va s’arranger", en sous-estimant les risques.
Le biais culturel : on croit que la technologie nous sauvera toujours, comme si l’humain était immunisé contre les crises écologiques.
Le biais de confirmation : on ne retient que ce qui confirme nos idées préférées, en ignorant le reste. Notre cerveau adore les informations qui le confortent, pas celles qui le bousculent.
Résultat ? Les opinions se radicalisent, surtout avec les réseaux sociaux, qui nous enferment dans une "bulle" en ne nous montrant que ce qu’on aime déjà.
Pire : plus une situation est grave, plus on a tendance à se dire "quelqu’un d’autre agira"… C’est l’effet spectateur : plus la foule est grande, moins on se sent responsable.
Et pour couronner le tout, nos habitudes de consommation, boostées par le plaisir immédiat (merci, dopamine !), rendent le changement encore plus difficile.
Bref, notre cerveau est câblé pour éviter l’effort… mais en prendre conscience, c’est déjà le premier pas pour agir !
Agir malgré tout : reprendre le contrôle
Faut-il pour autant se résigner à l’inaction ? Absolument pas. Nous assistons depuis quelques années à une mobilisation citoyenne croissante en faveur du climat.
Preuve que, malgré les résistances de notre cerveau, nous pouvons agir.
L’enjeu est donc de comprendre ces mécanismes psychologiques pour mieux les contourner. Plutôt que de céder au fatalisme, nous devons trouver des moyens de rendre l’action climatique :
plus engageante,
moins anxiogène
et plus en phase avec nos besoins de cohérence et de sécurité.
En somme, si notre cerveau peut être un obstacle, il peut aussi devenir un allié. À nous de lui montrer qui est le véritable « maître à bord » !
En comprenant ses effets sur notre cerveau, nous pouvons mieux anticiper ses conséquences et agir pour préserver notre santé mentale et cognitive.
Les neurosciences, en éclairant ce lien crucial, nous offrent une raison de plus de lutter contre ce phénomène qui nous concerne tous et par définition nous rassemble !
Restons vigilants, car notre cerveau en dépend.
📖 Ce qu’il faut retenir
Un cerveau sous pression : Les chercheurs ont observé que des températures trop élevées altèrent les fonctions cognitives comme la mémoire de travail et la prise de décision.
Chaleur et santé mentale 🧠 : L’exposition répétée à des températures extrêmes est associée à une augmentation des symptômes dépressifs et des troubles anxieux.
PS : on serait ravi d’avoir vos avis sur cette article. Alors, si vous avez la moindre question, la moindre anecdote, ou tout simplement l’envie de partager quelques choses avec nous, n’hésitez pas à commenter ci-dessous.
Pour aller plus loin 👀
👉 Livre : Le souci de la nature
👉 Vidéo : Climat - Mon cerveau fait l’autruche
⚡ Réactivation Neuronale
La meilleure façon de consolider ses apprentissages, c'est de les tester régulièrement (et ça, c'est prouvé par les neurosciences 😉). Réactivons ensemble ce que nous avons exploré la semaine dernière !
La semaine dernière, nous avons vu plusieurs choses dans cet épisode :
Pouvez-vous vous rappeler de ce dont nous avons parlé ?
Prenez 30 secondes pour essayez de vous rappeler au mieux…
…
[….]
….
Allez, on vous aide. Voici les 5 points qu’il fallaient retenir de cet épisode :
- Une première mondiale: des photons ont été détectés après avoir traversé 15,5 cm de tissu cérébral, malgré une atténuation d'un milliard de milliards de fois !
- Différences de langage : les personnes autistes parlent d'acceptation, tandis que les parents utilisent plus de termes médicaux 🏥
- L'exercice booste le cerveau à tout âge : améliore cognition, mémoire et fonctions exécutives, avec des effets visibles dès quelques semaines.
- Le cerveau teste plusieurs hypothèses spatiales en parallèle avant de choisir la bonne position, comme un GPS interne qui évalue plusieurs itinéraires 🧭
- Mission unique : les FROs concentrent toutes leurs ressources sur un seul objectif scientifique ambitieux, comme un "moonshot", avec des équipes stables et dédiées.🔭Voilà, c’est tout pour cette semaine !
Cérébralement vôtre,
Bertrand & Romain 🧠✨
PS: N’hésitez pas à partager cette newsletter avec vos proches / ami(e)s / collègue(s). C’est une bonne dose de motivation pour nous !
Et puis si vous n’êtes pas abonné, abonnez-vous ! 😊
PS: n’hésitez vraiment pas à nous faire des retours sur ce que vous aimeriez voir !
Disclaimer : Les informations présentées dans cette newsletter s'appuient sur des recherches scientifiques. Cependant, les résultats ne sont pas des certitudes absolues et représentent parfois des corrélations sans prouver de causalité directe. La science des neurosciences évolue constamment. Ces conseils sont des pistes de réflexion à considérer avec esprit critique.
👍 Likez | 💬 Commentez | ↗️ Partagez 👇






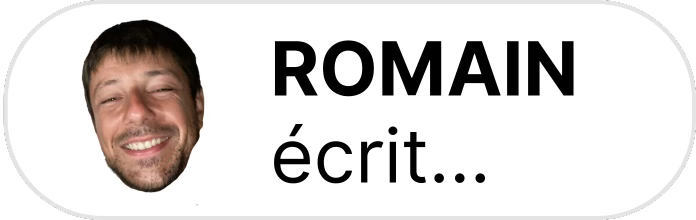

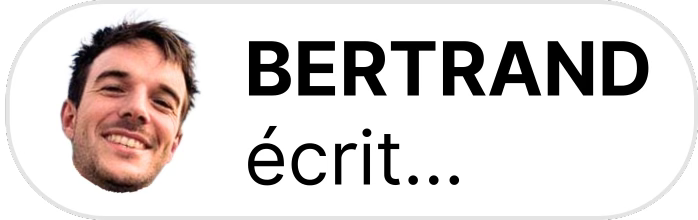

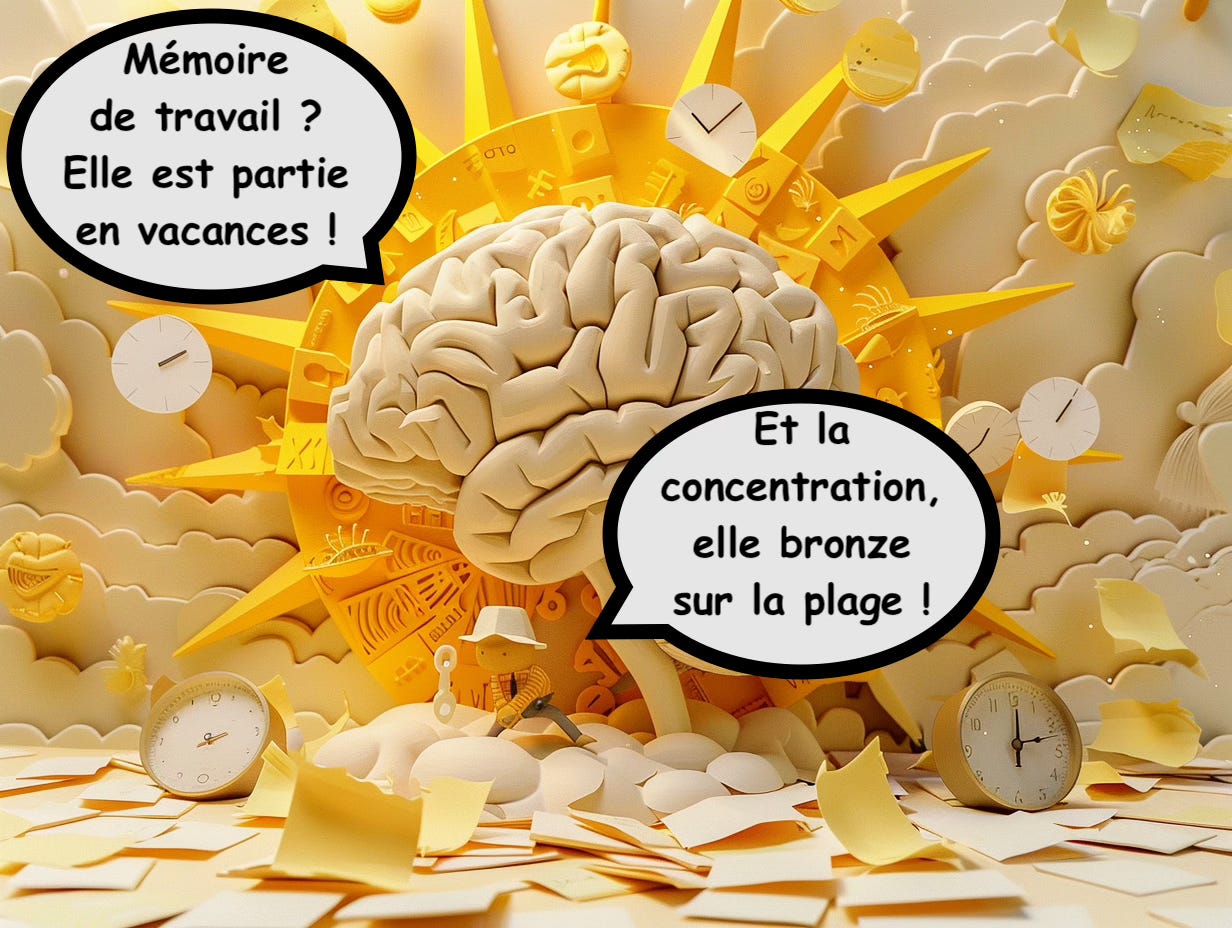




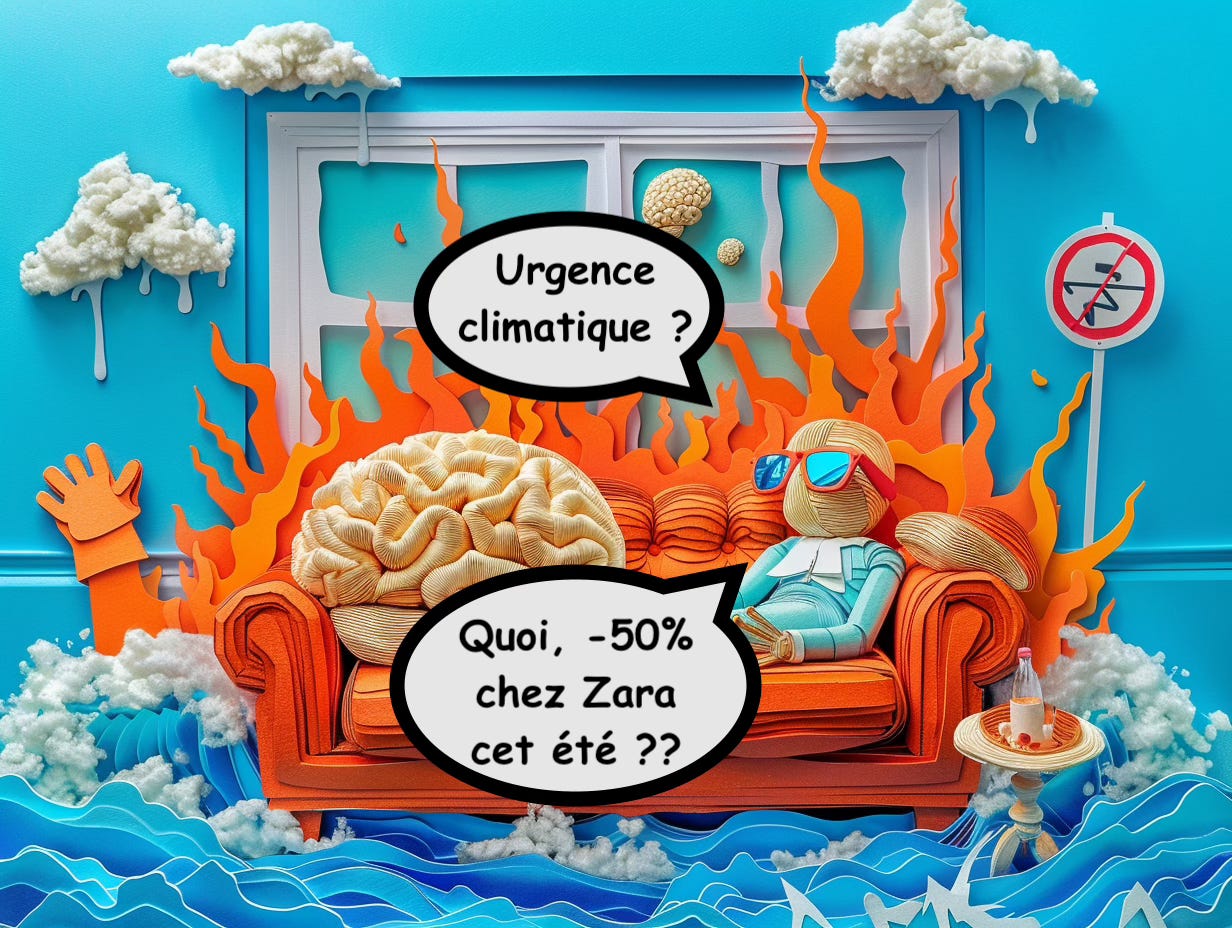


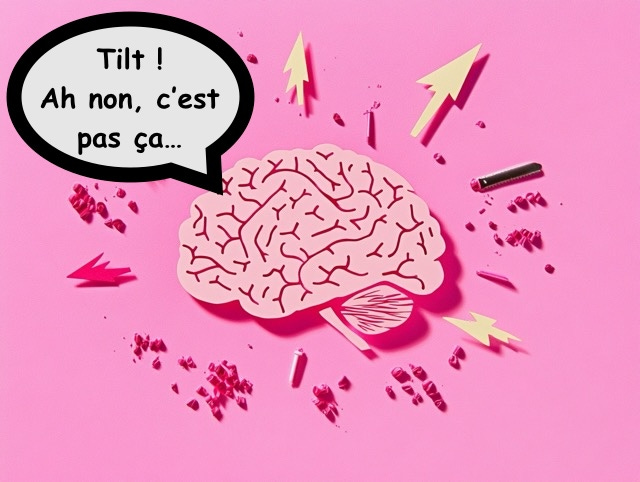

Très bonne analyse scientifique